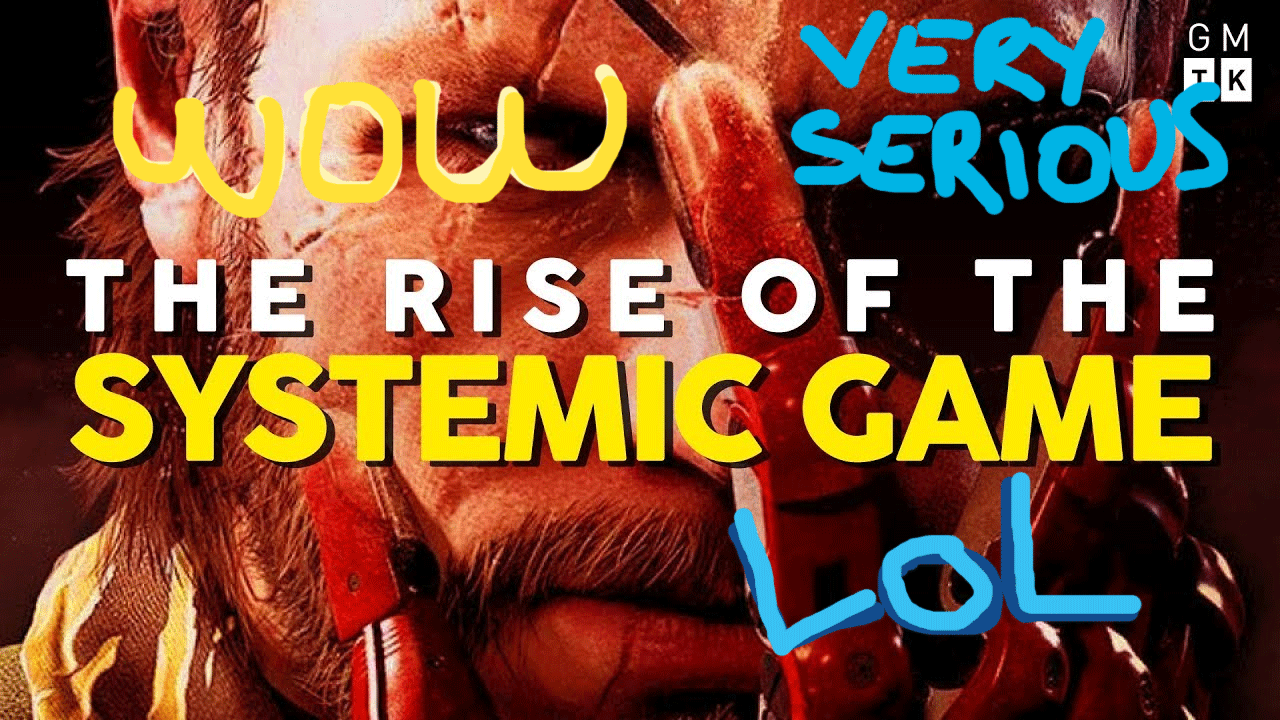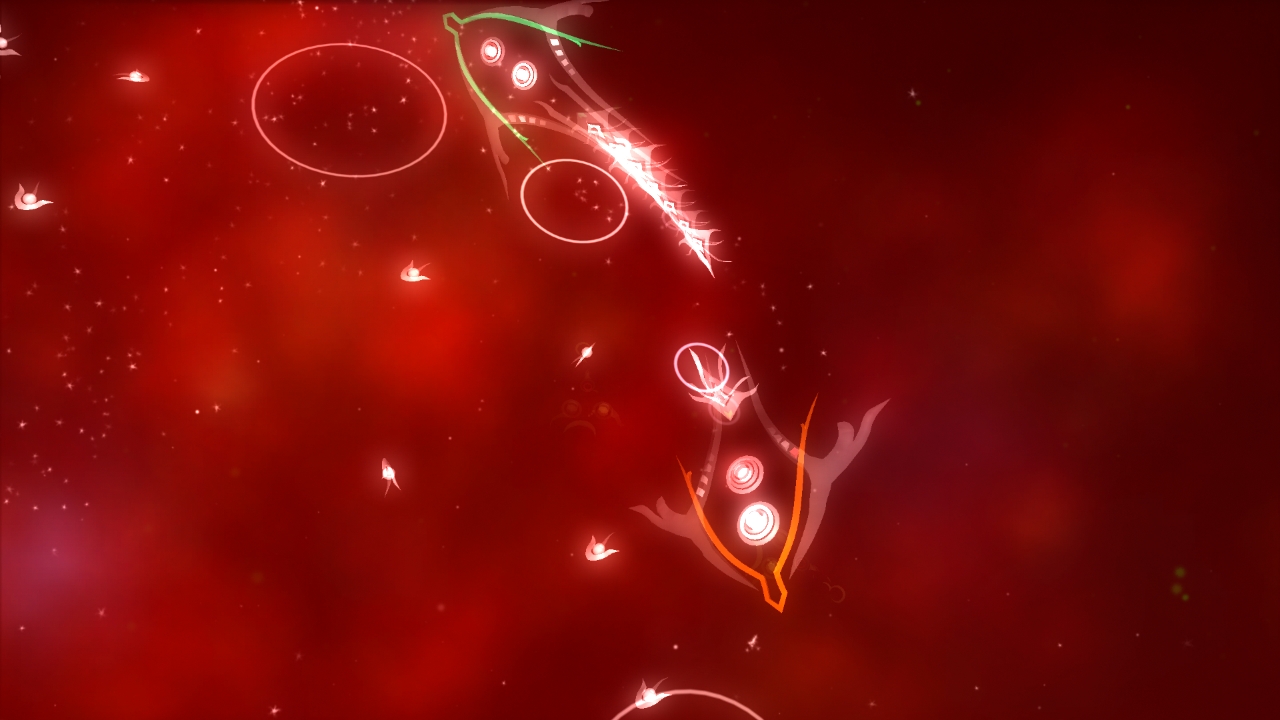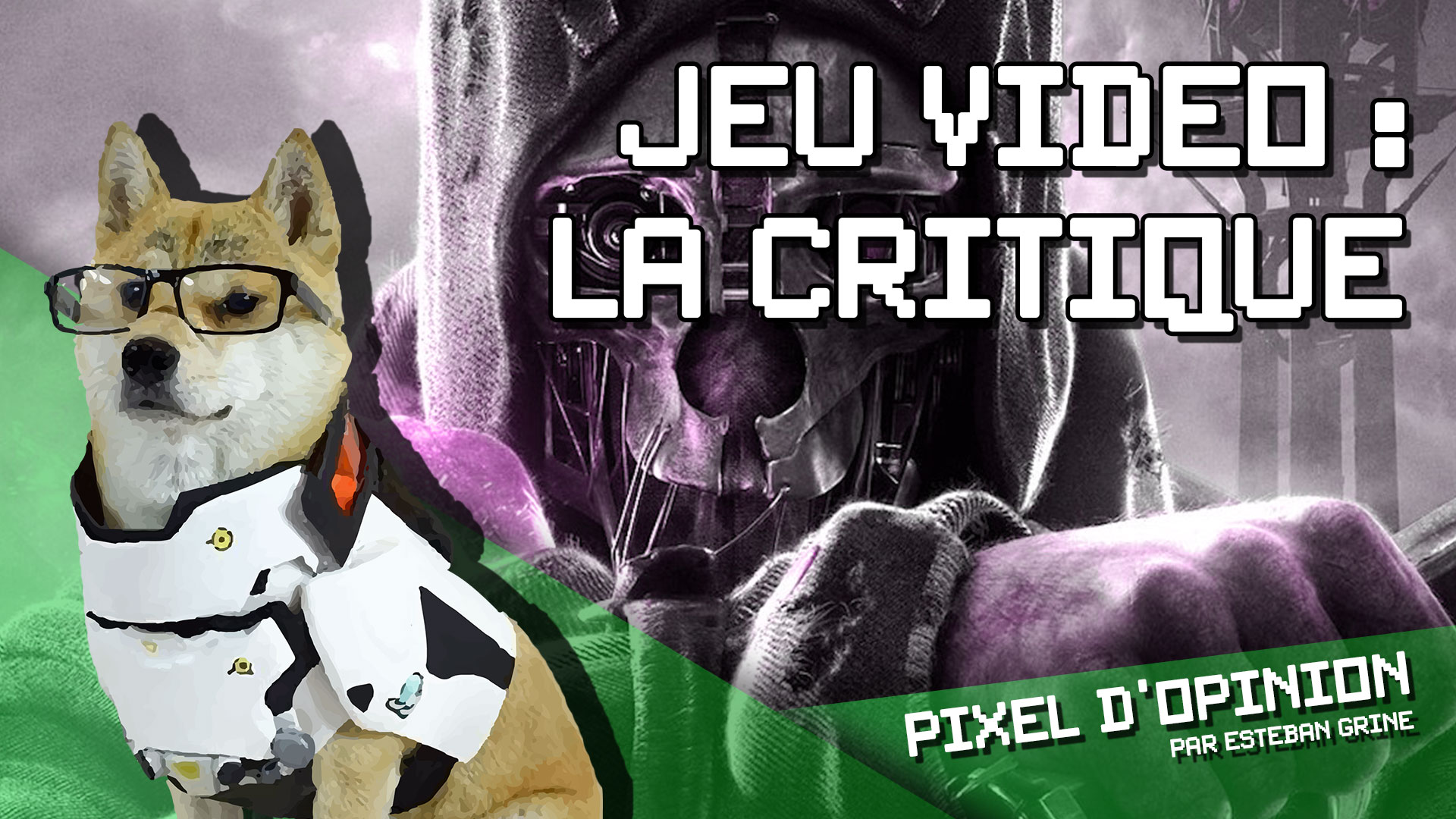Ce Noël, quelle ne fut pas ma surprise lorsque mes parents me tendirent le cadeau qui m’était destiné. Une fois l’emballage soulevé, je découvris avec émerveillement une Playstation 4 slim accompagnée de « Call Of Duty Infinite Warfare » (Activision, 2016). Moi qui suis plutôt vindicatif lorsqu’il s’agit des consoles de jeux vidéo, ces boîtes en plastique non recyclables, j’eus le sourire jusqu’aux oreilles et fus heureux de recevoir cet objet victime de nombreuses convoitises.
Pourtant par le passé, je n’ai jamais manqué de statuer sur la question des consoles de jeux vidéo. Dans de précédents billets d’opinions, j’avais déjà clairement établi mon point de vue à ce sujet : ce sont des objets extrêmement périssables soumis à des modes de consommation et des cycles de vie toujours plus courts, bref, l’antithèse de la consommation responsable. Pourtant, le sentiment de bonheur lorsque j’ouvris mon cadeau me débarrassa de tous mes dilemmes éthiques liés au développement durable. Je venais d’atteindre un Graal et pour rien au monde je n’aurais sermonné mes parents en les traitant d’inconscients pour m’avoir offert la dernière console de Sony. Je balayais donc d’un revers de la main toutes mes considérations politiques sur la façon de consommer notre média « jeu vidéo ».
Face à tant de contradictions présentes chez moi (et elles le seront surement encore après l’écriture de ce billet), il convient de se poser quelques instants et réfléchir à ce qui vient de se produire, un peu à notre médium et le recontextualiser au sein des différents loisirs accessibles ou non dans le monde car ce qui s’est passé à mon Noël est à mon sens représentatif de l’absence de prise de conscience concernant l’impact de nos comportements sur le monde en tant que joueurs.
Pour reformuler un peu et aller directement au fond de ma réflexion, je vais exposer dans ce billet les raisons qui me poussent à penser que le Jeu Vidéo est un loisir bourgeois et capitaliste. De même, je défendrai aussi le fait qu’il est un produit d’une certaine vision coloniale de l’utilisation des ressources de notre planète. De cette façon, j’espère pouvoir reconnaitre mes contradictions pour mieux affirmer le discours décroissant qui me semble aujourd’hui nécessaire pour faire du jeu vidéo un loisir durable et une forme d’expression pérenne.
Les bourgeois, c’est comme les cochons
Maintenant que j’ai attiré l’attention du lecteur, il convient de préciser ce que j’entends par loisir bourgeois. En aucun cas je ne remets en cause la caractéristique populaire de cet art. Le Jeu Vidéo est un média de masse et à aucun moment j’en viendrais à le comparer à certains loisirs comme « aller à l’Opéra », « jouer au golf » ou encore « aller écouter un orchestre symphonique ». J’entends par « loisir bourgeois » plutôt un rapport entre pays occidentaux et le reste du monde, où se trouvent les minerais, les matières premières et les moyens de production. Ainsi, j’entends plus le terme « bourgeois » dans un sens économique et marxiste : une classe sociale (l’occident) dominant une autre classe sociale (les pays producteurs). Ainsi, je considère que le jeu vidéo tel que nous le connaissons en France n’a été rendu possible que par l’exploitation de l’homme par l’homme. Nous pourrions rapidement convenir que tout notre mode de consommation français ne repose d’ailleurs que sur ce principe mais ce n’est pas parce qu’une caractéristique n’est pas unique au jeu vidéo (et à tout média de manière général) qu’il faut l’exclure de l’équation sous prétexte que « tout le monde est au courant ». Au contraire, je m’oppose clairement à ce type de propos que je considère comme une forme d’invisibilisation des problèmes et j’ai la conviction que c’est ce que nous faisons actuellement.
Ainsi donc, notre façon de consommer le média « jeu vidéo » est à mon sens possible uniquement par l’exploitation d’une population sur une autre mais il convient de préciser mon propos : toutes les façons et les supports de jeu ne sont pas égaux dans l’exploitation des ressources et du travail. Lorsque l’on observe rapidement les façons de jouer à des jeux vidéo de par le monde, nous pouvons observer une multiplicité des pratiques. Ainsi, la représentation majoritaire que l’on se fait du jeu vidéo en France est le jeu sur console ou sur pc tandis que la représentation majoritaire du jeu vidéo en Chine est le jeu sur smartphone. Une partie de ces représentations peut s’expliquer par le choix de politiques nationales en matière de supports de jeu. Ainsi, en Chine, ce n’est que très récemment que les consoles de salon ont véritablement pu pénétrer le territoire avec la bénédiction du gouvernement. Déjà, il apparait à mon niveau et dans cette réflexion que les représentations du jeu vidéo varient énormément géographiquement. Nous ne jouons pas de la même façon que l’on soit en France, en Allemagne, en Amérique du Nord ou du Sud, en Asie ou en Afrique.
La logique capitaliste de notre consommation de Jeux Vidéo
Si l’on observe maintenant les supports de jeu, nous nous apercevons que certains ont un plus gros impact sur l’immobilisation des ressources prises dans les pays producteurs des matières premières nécessaires. Ainsi, les consoles de salon et portables sont typiquement dans ma réflexion actuelle les supports de jeu le moins écologiquement soutenables puisque nous immobilisons des stocks de métaux et de plastiques qui ne seront peu ou pas recyclés. De même, l’utilisation que nous en avons montre que c’est un stock qui, contrairement aux smartphones ou aux ordinateurs, n’est immobilisé que pour une seule fonction : le jeu (et la consommation de médias, certes). J’oserai presque faire le pari que notre temps de jeu passé sur une console est inférieur à 5% du temps total de possession. Mon cas personnel en est clairement l’exemple. Je possède chez moi une Nintendo 3DS, console que j’affectionne particulièrement. Pour cette plateforme, j’ai fait l’achat d’environ une dizaine de jeux qui m’ont duré à peu près 40 heures soit 400 heures de jeu pour maintenant 2 ans et demi de possession soit à peu près 21 600 heures. Ainsi donc, sur le temps de possession de cette console, je n’y ai techniquement joué que 1,8% du temps, ce qui est ridicule pour l’immobilisation de ressources que cela implique et la quantité de travail qui a été nécessaire pour produire ma console portable.
Pourtant, en tant que joueur, nous valorisons énormément la possession de jeux et de supports de jeux. A voir le pédantisme et la prétention des personnes qui présentent leurs collections et surtout la mise en avant du montant monétaire que cette accumulation a nécessité, je me fais la réflexion que malgré les revendications politiques de gauche(s) que certains peuvent avoir, les joueurs de jeux vidéo restent (par leurs comportements) pour le moment des agents économiques qui s’inscrivent directement dans une tradition capitaliste mettant en avant la liberté individuelle d’immobiliser des objets qui nécessiteraient notamment d’être recyclés afin d’être réemployés. Et que cela soit clair entre nous, après réflexion, mon comportement s’inscrit malgré moi définitivement dans cette tradition capitaliste que je critique.
Le Jeu Vidéo Dématérialisé, fausse réponse à de vraies questions énergétiques
Certains pourraient argumenter que l’augmentation des ventes de jeux dématérialisés nuancerait mon propos, ce à quoi je ne pourrais m’opposer formellement à défauts d’observations. En réalité, ces individus ne seraient pas non plus à même de soutenir ces hypothèses sans preuve scientifique accompagnée d’une méthode épistémologiquement soutenable et réfutable. Cependant, je pose l’hypothèse que mes arguments restent valides pour la majorité des individus, joueuses et joueurs dont les pratiques ne correspondent pas à celles de l’utilisateur de services tels que Steam ou Gog. J’émets aussi l’hypothèse que la mise en avant du jeu dématérialisé ne résout pas la question des supports telles les consoles et les ordinateurs portables (tablettes, etc.). Enfin, je comprend tout de même l’argument que les jeux en boîte représentent eux aussi un gaspillage d’énergie puisqu’ils deviennent, à mon humble avis, de plus en plus en plus des simples clefs d’activation.
Néanmoins, il me semble que la sphère des quelques influenceurs (dans laquelle je m’insère) soutenant « ce projet potentiellement écologique du jeu dématérialisé » est peut-être dans une bulle culturelle (et probablement élitiste et pédante) qui ne représente aucunement la façon de jouer d’une quelconque « majorité » au niveau international. Nous ne nous intéressons que trop peu aux pratiques vidéoludiques des autres joueurs au niveau national et international et faisons beaucoup trop souvent la supposition qu’elles sont identiques aux nôtres peu importe le contexte. Or, il est facile d’imaginer qu’un individu vivant à Shanghai ne joue pas de la même façon qu’un individu à Sao Paulo, etc.
De manière générale, je soutiens que la question du dématérialisé est mal formulée puisqu’elle suppose que la consommation de jeux dématérialisés mobilise la même quantité d’énergie nécessaire que celle requise pour les jeux en boîte. Je ne peux malheureusement pas trop m’avancer sur ces éléments pour lesquels je n’ai pas de données à exploiter (mais voilà une piste de recherche qui serait fort passionnante à traiter). Ainsi, je reformulerai plutôt les enjeux de ces comparaisons uniquement par rapport à l’énergie nécessaire pour jouer. Formuler les choses dans ce sens permet de prendre en compte, à mon sens, la complexité de l’impact écologique du fait de « jouer à un jeu vidéo » sur l’environnement mais aussi les différentes structures des jeux (jeu solo, multi, en local ou non, etc.). Prenons par exemple le cas des jeux multijoueurs en ligne comme le très récent (et excellent) « Overwatch » (Blizzard, 2016). Celui-ci nécessite de nombreux acteurs diverses pour assurer la situation de jeu. Si l’on regarde l’impact de « jouer à Overwatch », nous avons donc :
Impact écologique d’un jeu multijoueur en ligne = Machine Client (dont coût de production) + Consommation électrique Client + Espace Disque Dur Client + Infrastructure Internet (réparti sur d’autres emplois) + Entretien de l’infrastructure (réparti sur d’autres emplois) + Machine Serveur (dont coût de production et d’installation) + Consommation électrique globale (intégrant les frais de stockage comme la ventilation, etc.) + coût d’entretien + Infrastructure serveur (la gestion du bâtiment, le réseau interne, etc.) + coût possible lié aux instances de partage et de streaming.
Pour le cas d’Overwatch, le calcul serait donc l’équation que je propose multipliée par 12 pour les 12 joueurs présents lors d’une partie. Cependant, je souligne maintenant l’amateurisme de cette équation étant donné que je ne suis absolument professionnel en terme d’ingénierie et la proposition que je fais n’a qu’une seule et unique vocation : ouvrir le débat et être corrigée.
Quelle solution pour réduire notre consommation d’énergie ?
Ainsi donc, avec cette façon d’envisager l’impact du jeu vidéo sur l’environnement (en observant l’énergie nécessaire pour jouer), il devient possible d’agencer les différents impacts écologiques des multiples pratiques vidéoludiques. Si cela pouvait être une évidence pour certains, cela me sembla intéressant de tout de même le rappeler ici. Ainsi, un joueur jouant exclusivement à des jeux axés sur des situations « en ligne » (se rapprochant ou étant des MMOG[1] donc) aura un impact plus important qu’un joueur ne jouant exclusivement qu’à des jeux présentant des contenus solos. Il devient aussi possible d’évaluer l’impact respectif des jeux en ligne, par exemple, un joueur d’Overwatch consommera probablement moins qu’un joueur de Battlefield (du fait de la taille des maps, du nombre de joueurs présents, etc). Enfin, il pourrait être intéressant de mettre en place un équivalent de l’indice Carbone dans les notices des jeux vidéo afin de prendre peut-être plus conscience de l’énergie mobilisée pour jouer. Ainsi, cette question de la consommation d’énergie soulève aussi les enjeux écologiques derrière de nouvelles pratiques qui pourraient sembler plus écologiques au premier abord. Je pense notamment aux services de streaming de jeu qui nécessiteront probablement énormément d’énergie et d’infrastructures.
Dans ce très long article, je me suis attaché à expliquer pourquoi le jeu vidéo est un loisir capitaliste. Il l’est car il se repose sur une logique d’accumulation de richesses qui vont être immobilisées sans possibilité de recyclage. Le Jeu Vidéo, tel qu’il est pratiqué en Occident, se repose aussi sur une idéologie colonialiste puisque c’est l’exploitation des richesses et des femmes et hommes en dehors de nos frontières qui nous permet un tel cadre de jeu. Enfin, les arguments servant à assoir cette forme de Jeu Vidéo s’inscrivent dans une réflexion que je qualifie plutôt de libérale, voire néo-libérale, avec le rejet et/ou l’invisibilisation des critiques qui peuvent être faites notamment.
Maintenant, le lecteur pourrait m’accuser de ne proposer aucune solution. Voici donc le moment choisi pour intégrer aujourd’hui certaines réflexions décroissantes au Jeu Vidéo. Je ne vais pas proposer ici une solution miracle mais plutôt observer ce qui se fait actuellement dans d’autres secteurs d’activités. Il convient donc d’observer les modèles économiques qui en ont émergé. Le modèle qui me semble le plus adapté au jeu vidéo pour répondre à l’ensemble des critiques que j’ai formulées est « l’économie de la fonctionnalité ». Dans ce modèle, les acteurs cherchent à remplacer les objets et les biens par des services, inversant ainsi les logiques de consommations. Un exemple récent de cette économie de la fonctionnalité concerne notamment les services professionnels de l’entreprise de pneus Michelin[2]. Plutôt que de vendre des pneus, Michelin vend des « kilomètres ». Cela a un double avantage. Premièrement, le client paie dorénavant pour le cycle de vie du produit avec une assistance s’il y a un problème. Deuxièmement, cela empêche les logiques d’obsolescences programmées puisque l’entreprise doit dorénavant produire les biens les plus solides possibles pour minimiser le coût de gestion d’un client. On pourrait totalement adapter ce modèle économique au Jeu Vidéo, notamment chez les constructeurs de plateformes dédiées. Plutôt que de créer des générations de consoles (des produits mis en vente), il devient intéressant de proposer des services : « jouer à des jeux vidéo ». Ces services pourraient prendre la forme d’abonnements annuels que les joueurs seraient prêts à payer pour ne pas avoir à changer de consoles à chaque nouvelle génération. Prenons l’exemple de Sony. Plutôt que de vendre des objets « Playstation », cette entreprise met en place un abonnement (une sorte « PlayStation Plus Plus ») qui mettrait à disposition du matériel de location chez le joueur. En contrepartie, celui-ci paierait un abonnement mensuel avec pour ne pas non plus pénaliser l’entreprise, un engagement d’une certaine durée de temps. En lisant ces lignes, j’ose penser que le lecteur comprendra immédiatement l’intérêt d’une telle démarche : le producteur doit dorénavant proposer la machine la plus performante, mais surtout la plus pérenne dans le temps pour ne pas avoir à subir la concurrence. D’un cercle vicieux, nous passons à un modèle plus soutenable.
Conclusion
Maintenant que tout cela a été évoqué, je ne pense pas avoir d’autres choses à dire qu’il serait pertinent d’ajouter ici. Je pense avoir présenté de nombreuses pistes de réflexions pour la personne s’interrogeant sur l’impact écologique de la pratique du Jeu Vidéo. Au-delà de cela, ce fut pour moi aussi l’occasion d’effectuer un travail introspectif sur les contradictions qui sont présentes chez moi entre mes volontés politiques, mon comportement de chercheur et mes habitudes de joueur. Malgré quelques formulations que certains pourraient considérer comme des attaques personnelles, je tiens à rappeler qu’à aucun moment, il n’y a eu cette volonté. Ce billet s’inscrit véritablement comme une entrée dans un carnet plus global de mes réflexions sur le Jeu Vidéo et ce, à un moment donné. Mon opinion changera probablement et cette trace me permettra de juger son évolution.
Dans tous les cas, cela me permet de construire un peu plus cette réflexion décroissante pour laquelle je milite tout en reconnaissant mes comportements qui ne sont ni meilleurs ni moins bons que ceux d’une autre personne et j’espère que cet article donnera des éléments de réflexions à ses lecteurs. En attendant, je souhaite que de nouveaux modèles pour la consommation de Jeux Vidéo apparaissent et suis impatient de voir comment l’économie de la fonctionnalité réinterprétera nos habitudes. A défauts, je continuerai de militer pour un usage plus humble et plus respectueux de l’environnement. ■
Esteban Grine, 2016.

Notes de bas de page
[1] MMOG : Massive Multiplayers Online Game
[2] Sources : http://economiedefonctionnalite.fr/en-pratique/michelin/