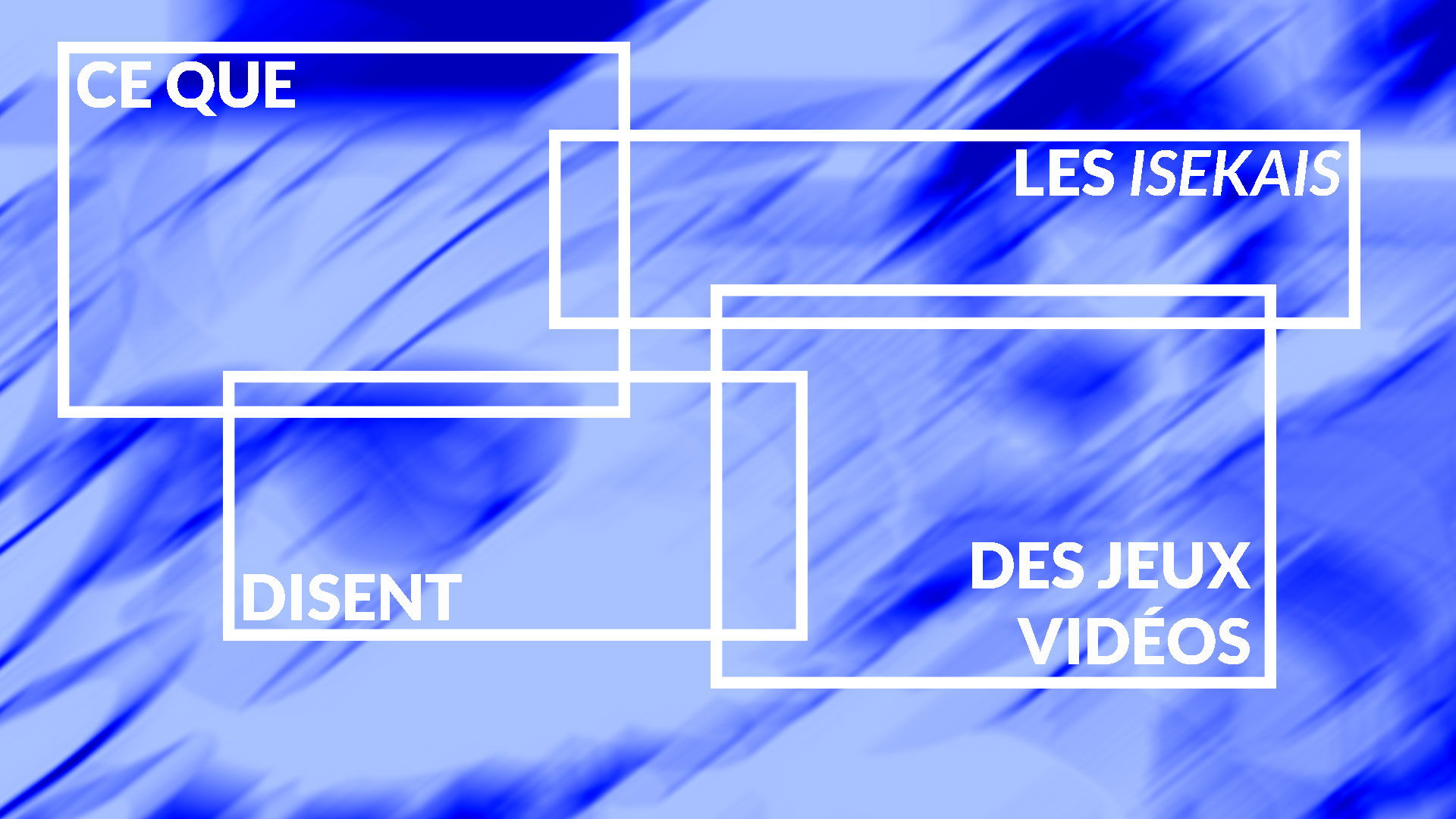Si je pose la question « après vous être représentés une personne jouant à des jeux vidéo, comment la décririez-vous ? » Je suis presque sûr de la réponse. C’est pourquoi par un heureux hasard et avec l’aide de la communauté discord que j’anime, j’ai rencontré Moeva et Gwénaël. Moeva est comorien. Il a eu la gentillesse de m’accorder de son temps pour une interview. C’est grâce à lui aussi que Gwénaël, franco-congolais, a aussi pris le temps de répondre à mes questions.
Il est difficile aujourd’hui de se représenter la façon dont le jeu vidéo se développe dans des pays autres qu’occidentaux et particulièrement les pays africains. C’est pourquoi les témoignages de Moeva et Gwénaël sont importants. A travers une interview écrite, ils nous partagent des éléments de réponses aux questions que l’on peut se poser concernant les jeux vidéo sur le continent africain. ■
Esteban Grine, 2018.
Il s’agit de la version 2.0 de l’entretien. Merci à Marc Boissonnot et Honeyxilim pour les corrections.
Une évolution de celui-ci sera prise en compte uniquement concernant la correction progressive des fautes de grammaire et d’orthographe.
Vous souhaitez participer à la relecture ? Cela se passe ici !
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter, raconter vos parcours et ce que vous faites aujourd’hui ?
Moeva : Je m’appelle Moeva Mondoha ! Je suis comorien de nationalité et d’origine. J’ai vécu toute ma vie dans différents pays d’Afrique : j’ai vécu aux Comores, j’ai vécu à Niamey au Niger où j’ai fait une partie de ma primaire, j’ai vécu au Burkina Faso à Ouagadougou où j’ai aussi fait une partie de ma primaire, et finalement j’ai vécu au Congo ou j’ai fait tout mon collège et le lycée dans une école française, et aujourd’hui je vis en France, et suis étudiant à E-artsup Bordeaux où je suis dans la formation Game et creative coding!
Gwénaël: alors pour faire court, je m’appelle Gwénaël Feuillard, j’ai 18 ans, et j’ai eu mon bac il y a bientôt 1 an de cela. L’année dernière j’ai passé des concours pour entrer dans des écoles de jeux vidéo que j’ai réussi. Cependant j’ai décidé de prendre une année sabbatique pour améliorer mon niveau en dessin car faire des études dans le jeu vidéo coûte cher, et je préférais prendre mon temps, et être sûr d’avoir le niveau pour ne pas me planter dès la première année. Et pour finir je voudrais être plus tard être développeur de jeux vidéo, même si je pense que c’était assez clair.
Quel est le plus vieux souvenir que vous avez et qui est lié au jeu vidéo ? Pouvez-vous nous le raconter ?
Moeva : Je peux pas affirmer que c’est véridique à 100% mais du plus loin que je me souvienne : quand j’étais bébé, aux Comores on était “en retard “ avec l’export et tout ça, on était clairement pas à la page niveau consoles et si je suis né en 1999 mes premiers pas sur des consoles étaient sur a vrai dire, une fausse console qui permettait de jouer avec des jeu de la Nes et des vielles consoles Sega. Ainsi mes premiers pas avec le jeu vidéo étaient Sonic et Mario, même si j’ai plus de souvenir avec Sonic, j’ai de cette époque finalement pas grand chose a dire.
Gwénaël : Pour ma part le plus vieux souvenir que je détiens en rapport avec le jeux vidéo, est celui d’Adibou sur un très vieil ordinateur à l’âge de 3 ou 4 ans. Dès l’instant où j’ai pu réfléchir, mes parents m’ont mis sur un ordinateur, il ne savaient pas vraiment s’en servir, mais vu que j’étais un enfant assez curieux j’ai assez facilement compris comment il fonctionnait ou du moins les bases et j’étais quasiment le seul à l’utiliser à la maison.
Est-ce que tu peux raconter un peu comment se passaient les temps de jeu vidéo ? (Organisation du temps, partagé avec les frères et soeurs, si les amis venaient jouer et tout)
Moeva : ça a vraiment beaucoup évolué avec le temps : Au début il n’y avait pas de restriction à ce niveau-là, avec mes frères et sœurs au début on jouait quasiment exclusivement sur des consoles portables, mais on jouait aussi sur console de salon et là on jouait toujours tous ensemble, le jeu vidéo à l’époque était quelque chose de familial avant tout, c’est très lié à là où j’ai vécu mais le jeu était vraiment vu comme un truc d’amis ou familial : je devais toujours privilégier les aventures multi pour que on puisse jouer quand il y avait des invités, ou quand j’avais de la famille avec moi. Avec le temps quand j’ai grandi, le jeu est devenu une expérience plus solo, moins des instants de famille. Je n’avais pas le droit d’y jouer en semaine sauf si j’étais avec des amis ou de la famille. Si je devais ici dresser une comparaison, je sais que pendant très longtemps, le jeu vidéo a été chez moi une pratique multijoueur plutôt qu’individuelle, mes parents ont d’ailleurs été plus méfiants vis-à-vis du jeu vidéo vraiment au moment où j’ai commencé a jouer seul plutôt qu’en multi avec mes amis ou ma famille.
Gwénaël : Dans un premier temps il est important de savoir que je suis l’aîné d’une fratrie de quatre frères et sœurs, et j’ai aussi un demi frère âgé de deux ans de plus que moi. En ce qui concerne les temps de jeu ils ont énormément variés entre mon enfance et maintenant. Lorsque j’étais petit j’avais le droit de passer une heure sur ma console ou bien une heure sur l’ordinateur. Et généralement on ne jouait pas à des jeux multijoueurs en tout cas à l’époque où il n’y avait que moi, ma sœur et mon grand frère qui ne venait que pendant les vacances. En plus de cela nous n’avions à l’époque que des expériences solo, ce qui nous limitait. Puis mes deux autres frères et sœurs sont arrivé et la Wii avec, ce qui a poussé mes parents à acheter des jeux multijoueurs. À partir de ce moment le temps de jeux s’est multiplié par 3 voir même 4. De plus j’avais aussi une télé dans mon grenier que j’utilisais et sur laquelle je pouvais passer des heures sans que personne ne le sache vraiment.
Vous vous êtes pas mal baladés dans plusieurs pays d’Afrique, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur les marchés du jeu vidéo ? Y’a t-il des pratiques particulières que tu n’as vu que dans ces pays ?
Moeva : Tout un tas à vrai dire, et je les connais surement pas toutes : En Afrique le premier truc que tu remarques vis à vis du jeu vidéo c’est en allant au marché, tu peux trouver énormément de consoles contrefaites, ou des consoles hack en vente (forcément des consoles hack de consoles rétro). En prenant en compte le prix que représente l’exportation, tout est plus cher la bas. Déjà que le jeu vidéo, ça reste une pratique qui demande beaucoup de moyens, bah forcément en Afrique avec le prix de l’export et le niveau de vie moyen des Africains, c’est encore plus compliqué. Alors tout un tas de truc alternatifs s’est développé : déjà les fausses consoles qui sont vachement présentes dans les marchés, mais aussi le faite de “cracker les jeux “ et les “consoles”, j’irais pas jusqu’à dire que c’est ultra répandu en Afrique ou même que c’est unique là bas mais clairement c’est un truc “ancré” à la consommation du JV.
À vrai dire je pourrais élargir à la “culture” tout court en faite, dire qu’on “crack”, ou regarde illégalement des trucs en France ça fait toujours un peu grincer des dents, mais en Afrique avec la vitesse de la connexion, le prix de l’export + le manque d’infrastructures pour consommer des œuvres culturelles (on a pas de Fnac, être livré en Afrique c’est plus compliqué, le prix de l’export + le niveau de vie). Tout ça fait que on est beaucoup plus décomplexé sur ces choses là, aux Comores par exemple je sais que certains allaient au cybercafé rien que pour faire des téléchargements illégaux.
Pour répondre aussi à la question de base, il faut noter un truc important : il y a pas vraiment de marché du JV en Afrique, dans le sens où on ne représente pas du tout une cible ou à la limite une toute petite cible, et il existe quasiment pas de secteur du JV à part quelques petits studios indépendants qui naissent. À mon sens ce n’est pas grave, ça finira par venir, je reste persuadé que si il doit avoir quelque chose qui se développe en Afrique ils donneront les moyens pour que ça prenne réellement forme !
Gwénaël : Dans mon cas j’ai vécu en Afrique et plus précisément au Congo pendant 6 ans, de 2011 à 2017, sans jamais remettre un pied sur le territoire français. Cela signifie que j’étais complètement ancré dans la culture congolaise et que j’ai pu en voir toutes les facettes, pas seulement celles que certains de mes camarades de classes expatriés voyaient, mais aussi celles des classes moyennes et populaires congolaises. Pour ce qui est du marché du jeu vidéo dans ce pays, il est très particulier. Je me suis souvent promené dans des marchés avec ma mère et en fait en y restant juste quelques heures on comprend que plus de 90% des produits s’y trouvant sont d’origine asiatique et très souvent de mauvaise manufacture. Les consoles n’échappent pas à ce phénomène. Le Congo étant un pays riche ne redistribuant pas ses richesses, il se retrouve avec une population très pauvres vivant avec des salaires moyens de 60000 francs CFA par individu (95€). De ce fait il est impossible pour les classe populaire de s’offrir des consoles dernière génération à 400€ depuis les pays occidentaux car en plus de cela il faut cumuler les frais d’importation qui font souvent flamber les prix. De cela résulte deux conséquences. La première étant l’arrivée en masse de contrefaçons de consoles des générations antérieures, car elles contiennent des éléments, des pièces à coût moindre. La seconde est une organisation du jeux vidéo en salle de jeux, un peu à la façon des salles d’arcade, les gens se retrouvent dans ces salles de jeux avec moins d’une dizaine de consoles, et paient tout simplement 25 ou 50 francs CFA pour jouer une partie sur fifa. Cela les pousse d’ailleurs à n’utiliser qu’une très petite gamme de jeux se limitant souvent aux simulations sportives, mettant de côté toutes les expériences plus individuelles.
Finalement, vous en tant que joueurs, comment a évolué votre pratique depuis que vous êtes enfants jusqu’à ce que vous arriviez en France ?
Moeva : Quand j’étais petit , jusqu’à ce que j’ai la wii, je jouais énormément en multi, car j’avais une famille grande, et les jeux vidéo ont toujours chez nous eu cet aspect très familial, à la limite je jouai en solo uniquement sur GBA et DS. Mais en grandissant ça a changé je jouais moins avec mes frères et sœurs et peu à peu je me suis tourné vers les expériences solo, et avec mon pc peu puissant j’ai beaucoup joué aux jeux indés et fait de l’émulation et sinon je jouais aux MMO japonais avec des amis car ça consomme pas beaucoup de connexion.
En France je me suis mis à beaucoup plus jouer en multi sur divers jeux avec mes amis d’un peu partout.
Gwénaël : En grandissant ma pratique du jeux vidéo s’est pas mal diversifiée, je passais la quasi totalité de mon temps avec Moeva, ce qui fait que j’ai les mêmes influences que lui pour la plupart. Je n’avais pas de connexion internet au Congo, du fait que j’étais dans une zone très mal couverte, ce qui fait que la plupart des jeux que j’essayais étaientt ceux que Moeva téléchargeait et les moins lourds étaient effectivement les jeux indépendants. J’ai aussi joué aux MMORPG d’Ankama à partir de mes 10 ans, qui je pense d’ailleurs font partie des jeux à m’avoir donner envie de faire du jeu vidéo. Puis en première et terminale, je ne faisais que travailler ce qui a considérablement fait baisser ma consommation de jeux vidéo qui a été presque réduite à néant.
Comment en es-tu venu à vouloir devenir game designer ? Que souhaites-tu faire après ?
Moeva : J’ai vraiment voulu devenir Game designer au collège/début de lycée, j’avais des amis à moi aussi qui voulaient le faire, et j’avais passé toute mon enfance a jouer au même jeu sur GBA, donc j’avais appris les mécaniques par cœur et je m’amuse à les analyser ou me poser la question de comment les améliorer, mais le véritable déclic c’est vraiment la découverte de ceux qui parlent de JV sur le YT français : a l’époque Ixost avec sa vidéo sur GTA IV qui m’avait marqué a un point incroyable, Pseudoless, et surtout Doc Géraud, tout ça ma fait me poser beaucoup de questions sur mon rapport au jeu vidéo, et surtout ça m’a fait réaliser tout ce que je pouvais faire avec le GD. C’est indirectement lié à là où je vivais : mais le fait que j’avais une mauvaise connexion a fait que je me suis directement tourné vers l’indépendant : là où watch dogs cotait 50e et j’y avais joué deux heures de déception, les jeux indépendants me demandaient une heure ou une nuit de téléchargement, tournaient sur mon pc daté et m’offraient des 100aines d’heures de jeu. D’ailleurs la vidéo faite par Tom_V parlant de l’avenir du jeu vidéo, en évoquant la décroissance : d’une certaine manière l’idée de composer avec ce que on a déjà et non pas chercher toujours une innovation contradictoire avec nos moyens, c’est quelque chose que je trouve déjà ancré en Afrique surtout dans mon pays d’origine les Comores.
A l’heure actuel plus tard j’aimerais pouvoir continuer à travailler dans le jeu vidéo en France.
Gwénaël : J’aimerais d’abord souligner le fait que je ne veux ni devenir game designer ni game artiste mais plutôt développeur de jeux vidéo. Je sais que cela peut paraître très idéalisé et je ne sais même pas si le terme est correct mais par là je veux dire que j’aimerais un jour pouvoir gérer chacune des facettes de la conception à la production d’un jeu.
Je sais qu’aux yeux de certains cela peut paraître cliché, mais si j’ai d’abord eu envie de créer des jeux vidéo, c’était pour compenser ce que je ne pouvais pas faire dans certains. Ainsi j’ai commencé à prendre des notes, à faire des brouillons, à dessiner des armes que je n’avais pas dans le jeux, des objets, des cartes. Puis en 2010, j’ai découvert little big planet 2 qui fut ma plus grosse révélation sur un jeu, car ce dernier me donnait littéralement accès à un moteur de jeu gratuit, certes limité mais qui était déjà extrêmement ouvert pour un gamin de 11 ans; il permettait à la fois de construire ses environnement, mais aussi de leur imposer des contraintes physiques, de gérer le niveau d’eau, de brancher des moteurs et même de créer des petits robots appelés les sackbot auxquels on pouvait assigner un comportement. Ainsi j’ai plus ou moins découvert les rudiments du level design.
Aujourd’hui, quel sont vos regards sur la représentation des cultures africaines dans les jeux vidéo ? Arrivez-vous à citer des jeux qui y font référence ? Quel type de jeu semble le plus apprécié? En terme de visibilité, quelle image a le jeu dans les différents pays où il a pu vivre ? Quelles sont les références de jeux les plus connues/répandues? (question de Missmyu)
Moeva : Je trouve que les culture africaines ne sont pas assez représentées dans le JV, c’est dommage pour des raisons évidentes de représentation mais surtout : c’est tout un plan idéologique et mythologique, il y a une richesse folle pour créer des histoires qui est finalement peu, voir pas du tout exploité surtout dans le média jeu vidéo( sauf exception comme le cas du jeu indépendant Aurion : L’héritage des Kori-Odan) , au cinéma il y a Black Panther qui a touché le grand public, mais a mon sens il reste beaucoup à faire, je n’arrive pas vraiment moi-même à citer des jeux auxquels j’aurais joué qui y font directement référence.
C’est peut être un peu hors sujet, mais je trouve important de noter qu’en Afrique une des problématiques dans les œuvres culturelles et même en général est de se détacher des cultures occidentales, dans le sens où culturellement un peu comme partout, on a été touché par la mondialisation, et surtout par la culture française. Quand il s’agit de nous même en créer on a tendance à suivre les standards et tenter de reproduire les schémas des œuvres d’autres pays surtout celles françaises, toute la question est vraiment de savoir exploiter nos propres codes et notre culture et c’est lié a vraiment tous nos médias a mon sens.
Ça varie vraiment d’un pays à un autre mais je sais que de manière générale les jeux les plus appréciés sont les AAA, où que j’ai pu aller, là-bas on a moins la culture du “rétro” en tout cas au niveau du jeu vidéo, ce qui est nouveau est synonyme de meilleur, là-bas avec l’accessibilité compliquée à internet, bah la télé reste un média dominant et les trucs qui marchent sont ceux qui ont le meilleur brassage médiatique, donc les jeux les plus connus sont à base de Assassin’s creed, Call of duty, GTA. Nintendo par exemple garde vraiment une image de console de jeu pour enfant. D’ailleurs quand je dis qu’on a pas la culture du “rétro”, il faut noter malgré tout que par exemple dans mon pays qui est très “en retard” sur le plan technologique, jouer a la PS2 ne fait pas de mal, les consoles les plus récentes sont favorisées mais on y joue pas dans l’optique de jouer à des vieux jeux.
Gwénaël : Contrairement à ce que l’on pourrait croire, certaines cultures africaines sont représentées dans les jeux vidéo, par exemple dans le dernier Assassin’s creed ou encore dans Uncharted 3. Cependant ce sont toujours les mêmes pays d’Afrique qui sont mis en avant, et le problèmes est que l’on ne représente jamais l’Afrique dites de “noire”; ou du moins c’est l’impression qui en ressort. Et pour ce qui en est Moeva a quasiment tout dit au dessus.
Un regard spécifique est il porté sur le fait que les productions soient essentiellement focalisées sur des personnages blancs? Un regard spécifique est il également porté sur la pratique du jeu vidéo dans le reste du monde? (question de Yue)
Moeva : je ne pense pas, mais le fait que les productions sont essentiellement focalisées sur des personnages blancs a un impact, même tout simplement le fait qu’on soit focalisé sur des problématiques occidentales, si autre part dans le monde la légitimité du jeu vidéo a encore du mal à trouver sa place, dans le jeu vidéo encore plus, il est là-bas véritablement considéré uniquement comme un média de divertissement. Toute la profondeur est moins présente voir pas du tout, pour finalement tout un tas de raisons : les productions qui trouvent écho sont les plus grosses sorties : entre un Call of duty, ou un Far cry, dur de s’y retrouver dedans en terme de thématiques ou problématiques.
Gwénaël : La question du personnage blanc ne se pose pas dans un pays tel que le Congo où le jeu vidéo se pratique comme à l’époque des salles d’arcades, le gameplay passe avant tout, le but est clairement de prendre du plaisir et du bon temps entre amis. De plus il est important de noter que malgré la colonisation, et les guerres que le pays a pu vivre, le congolais est un homme très pacifique et possède l’une des populations des plus métissées ; adorant tout simplement faire la fête et vivre. Le fait de se questionner sur la couleur d’un personnage n’aurait pas de sens pour eux car leur philosophie de vie se centre beaucoup plus sur leur façon de vivre tel que l’art de la sape, leur problèmes d’eau ou encore d’électricité ou autres problématiques du même type. Ce n’est même pas qu’il n’aimerait pas se questionner dessus, c’est tout simplement qu’il n’ont pas le temps pour cela.
Est ce qu’on entend du jeu vidéo que « ça rend violent » ou autres formes de clichés? Est ce que la prévention existe, les PEGI et tout le reste ? (Question de Yue)
Moeva : l’idée que le jeu vidéo rend violent est finalement pas du tout répandue, j’imagine qu’en cherchant on trouvera des gens qui l’affirment mais très honnêtement en Afrique, les gens ont tendance à voir le jeu vidéo comme un simple divertissement. Ils ne trouvent pas ça néfaste dans le sens de rendre violent. Il arrive de trouver des gens disant que c’est pour les enfants ou que c’est abrutissant, mais pas la question de la violence, ça s’explique aussi car toute les questionnements apportés depuis des années sur la question de la censure des œuvres en rapport avec la violence et autre et un débat qui au final en Afrique n’a jamais eu véritablement d’écho. En ce qui concerne le “PEGI” c’est le système hérité de France, et honnêtement la prévention autour n’est vraiment pas respectée, les limites d’âge ne sont pas respectées, mais toute les pubs à la télé pour prévenir des dérives, on les a aussi en général.
De vos expériences et vécus, pouvez-vous nous raconter comment cela se passe entre les gouvernements et leur gestion de l’Internet ? Quel impact cela a sur le jeu vidéo ?
Moeva : Pour le coup je vais parler uniquement du Congo car il est le cas le plus grave, et celui que je connais le mieux :
J’ai vécue à Pointe-Noire, je pourrais pas décrire totalement la situation politique mais c’est tendu, vraiment tendu, c’est de nom “ une démocratie “ mais finalement pas vraiment, voir pas du tout, c’est pas le sujet ici mais une chose est sûre : Internet est un atout de poids et ils le savent. Je suis moi-même un millenial qui a passé sa vie sur internet et qui assisté à tout un tas de phénomènes qui ont été possibles grâce à Internet. Malgré le fait que j’ai moi-même grandi en Afrique donc avec un accès plus restreint à Internet, je sais que c’est un atout incroyable. Dans un pays comme le Congo qui subit actuellement de forts conflits même s’ils ne sont pas directement apparents, et surtout qui essaye de garder une bonne image et maintenir “l’ordre”, Ils (les autorités, ndlr) font un truc simple en cas de troubles politiques : mon année de première il y avait des périodes d’élections présidentiels, et pendant 1 semaine il n’y avait plus de connexion internet et pas d’accès aux réseaux sociaux et c’était clairement assumé. Empêcher tout rassemblement de se créer, couplé au fait qu’il était clairement déconseillé au gens de sortir de chez eux pendant cette période, c’était vraiment spécial.
La particularité de tout ça c’est que ça coupe à la fois le monde de toute information car le pays ne communique plus et empêche toute forme de rassemblement et les gens de se tenir au courant, quand je discutais avec des personne vivant à Pointe-Noire loin des endroits calmes, certains me racontaient que c’était le chaos, d’autres pouvaient me raconter des choses véritablement horribles, c’était d’autant plus flagrant car les membres de Total (une compagnie de pétrole en étroit lien avec le gouvernement, mais qui possède énormément de privilèges au Congo) et leurs familles étaient enfermés dans des résidences spécialement pour eux, et à tout moment si ça dégénérait trop, ils étaient renvoyés directement en France.
Je m’éloigne pas mal du sujet de base, mais c’est pour insister sur l’idée que surtout au Congo, à Pointe-Noire, on a compris l’impact d’Internet, et le pouvoir que ça a et dans un pays qui subit de forts troubles, l’état connaît le poids que peut avoir internet et fait très attention à la manière dont il le gère. Je ferai constater qu’aujourd’hui je suis à l’aise pour parler de tout ça car je suis moi même en France, mais j’aurais jamais pu raconter tout cela quand j’y étais encore.
Honnêtement la pratique du jeu vidéo est finalement très peu impactée par tout ça.
Gwénaël : Donc comme Moeva j’ai vécu dans la ville de Pointe-Noire au Congo durant 6 années. Cependant je sais qu’à son opposé j’aurais tendance à dédramatiser la chose, ou du moins à concentrer mon attention sur d’autres points.
Alors en ce qui concerne le rapport de ce pays à internet, la majeure partie de la population n’y a pas accès, ou du moins n’y a pas accès de la même manière que les occidentaux. En france, la vitesse moyenne de l’adsl se situe aux alentours de 5 mo/s ; cela peut quelquefois être plus rapide ou plus lent. Au Congo la vitesse moyenne de la 3g se situe à moins de 200ko/s. Nous pouvons déjà y percevoir un manque de moyens techniques et d’intérêt évident de l’État pour les moyens qu’il met dans cette technologie. De plus les câbles internet passant par la mer cèdent tous les 6 mois ce qui n’arrange en rien la situation. Maintenant parlons du rapport de la population à internet et les principales activités qu’elle y pratique. Pour avoir passer beaucoup de temps avec les congolais, et de toutes les catégories sociales, allant du plus riche au plus pauvre, je sais et ce d’expérience que les congolais n’utilisent internet quasiment qu’à travers les plus grosses applications de communications tel que Facebook, Whatsapp, Instagram et très peu d’autres. Des applications tel que Snapchat n’ont pas leur place, étant donné les capacités de la connexion. De plus au Congo, l’utilisation des ordinateurs est limitée, coûtant trop cher, la quasi totalité de la population n’y a pas accès. Leur utilisation se régit donc un peu de la même manière que pour les consoles, cette fois ce sont les cyber cafés qui permettent la location de ces machines à l’heure. Enfin, l’État encore une fois n’arrange pas la chose, en ne nationalisant pas les entreprises distributrices de l’internet, il n’a pas la capacité de réduire les frais d’internet, ce qui fait que les entreprises ont la possibilités de placer le prix de ce dernier là où elle le veulent. Là où un abonnement coûte une vingtaine d’euros en France, au Congo il en coûtera 150 pour une connexion avec un débit bien plus faible.
Passons maintenant au rapport entre le gouvernement congolais et internet. En mars 2016 ont eu lieu les élections présidentielles ; durant une période d’un mois nous avons été coupé du monde. Il est vrai que cela empêchait les gens de communiquer entre eux, de partager leurs avis vis-à-vis de la situation et de leur vote. Cependant, pour moi qui n’avait déjà pas l’habitude de passer mon temps sur internet, la sensation d’être coupé du monde existait déjà et je m’y étais fait, le congolais moyen aussi s’y était déjà fait. Le fait de couper internet était peut-être pour le président Denis Sassou Nguesso un moyen d’empêcher les gens de se rassembler et d’échanger, cependant le mauvais rapport de l’État vis-à-vis d’internet a habitué les congolais à user d’autre moyens de communications que ce dernier tel que les camions passant avec des prospectus pour annoncer les rassemblements. Je pense que c’est un peu hors sujet, mais il était tout de même nécessaire pour moi de mettre la lumière cela et bien faire comprendre que tout n’est qu’une question de point de vue.
Quand à ce qui est de son influence sur le jeu vidéo, je vous dirais que vu les moyens de consommation actuel du jeu vidéo au Congo, les vendeurs ont surement déjà craqué tous les jeux possibles et imaginables sortis sur les consoles jusqu’à la ps2 à peu près. Pour moi, une coupure d’internet pendant 1 mois n’a pas pu les gêner durant les élections présidentielles. Ils avaient largement de quoi consommer durant longtemps des jeux vidéo. Cependant il est vrai que cette coupure d’internet a pu effectivement gêner une toute petite partie de la population qui est la population expatriée. Elle ne représente pas plus de 2% de la population congolaise, cependant ce sont eux qui concentrent toutes les richesses et qui peuvent se permettre de conserver un mode de vie occidentale beaucoup plus accroché à la culture d’internet . Ainsi ces gens ont pu subir un changement dans leur manière de consommer les jeux et même de consommer l’information.
Merci beaucoup Gwenaël et Moeva ! A la prochaine ! ■