-

Night City : société du spectacle et du meurtre
Ce n’est pas un mystère, cela fait très longtemps que je travaille sur les façons dont les jeux vidéo nous invitent à faire l’expérience de comportements éthiques et moraux. Cela a été l’un des sujets pendant toutes mes années de thèse, et si aujourd’hui j’écris encore là-dessus, c’est parce que j’ai l’impression de voir un…
Le carnet de recherche d’esteban grine.


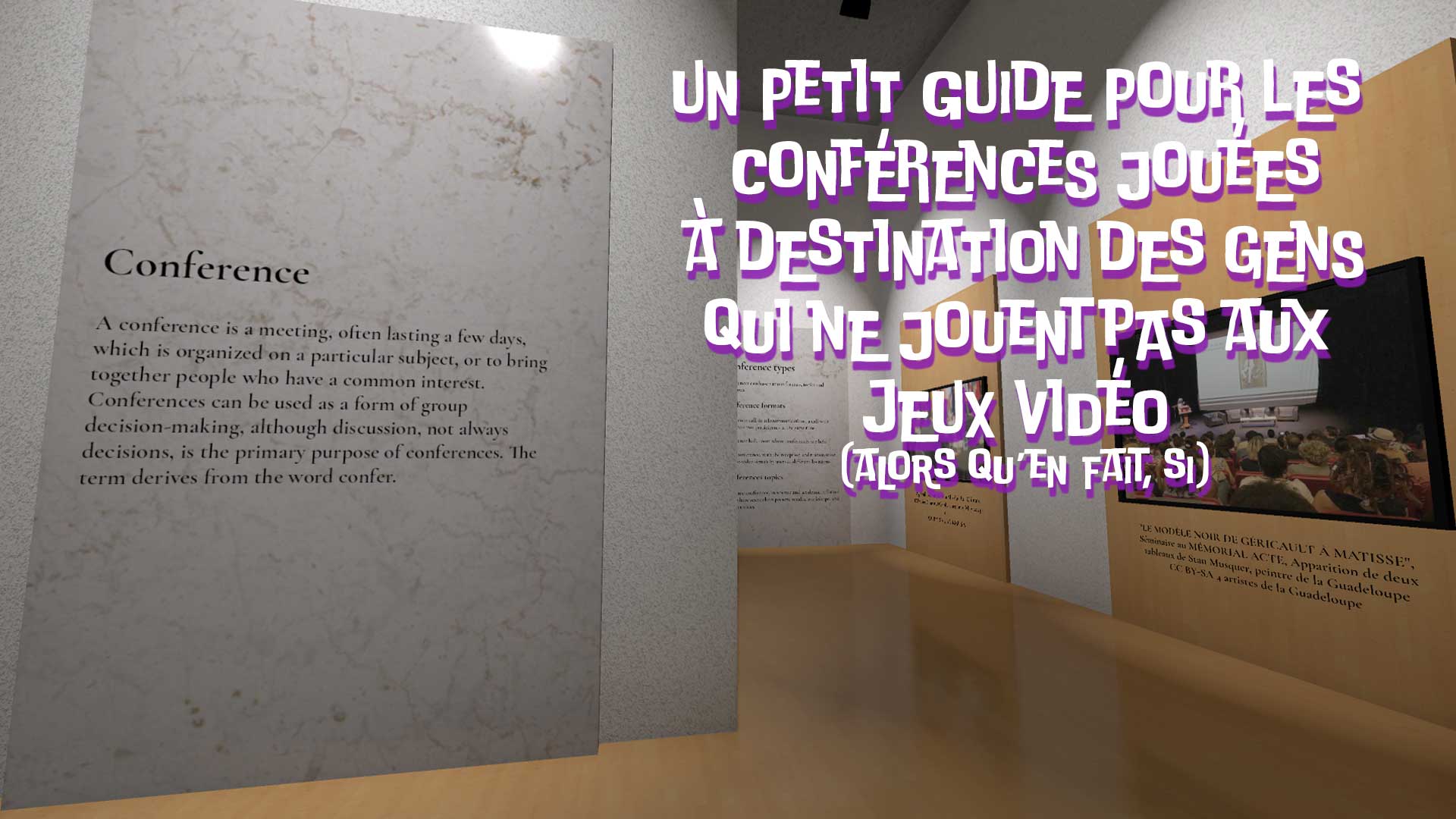


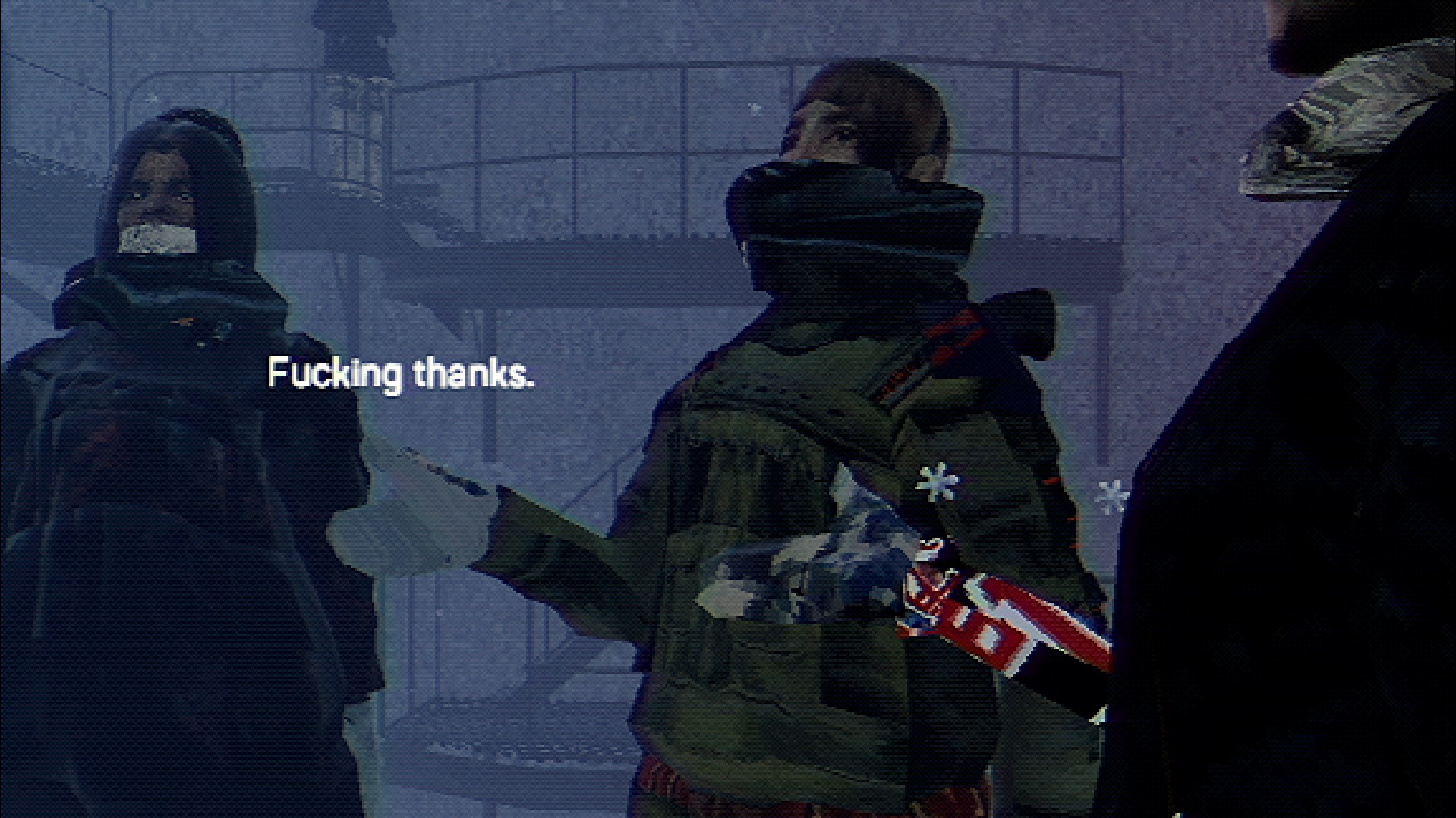


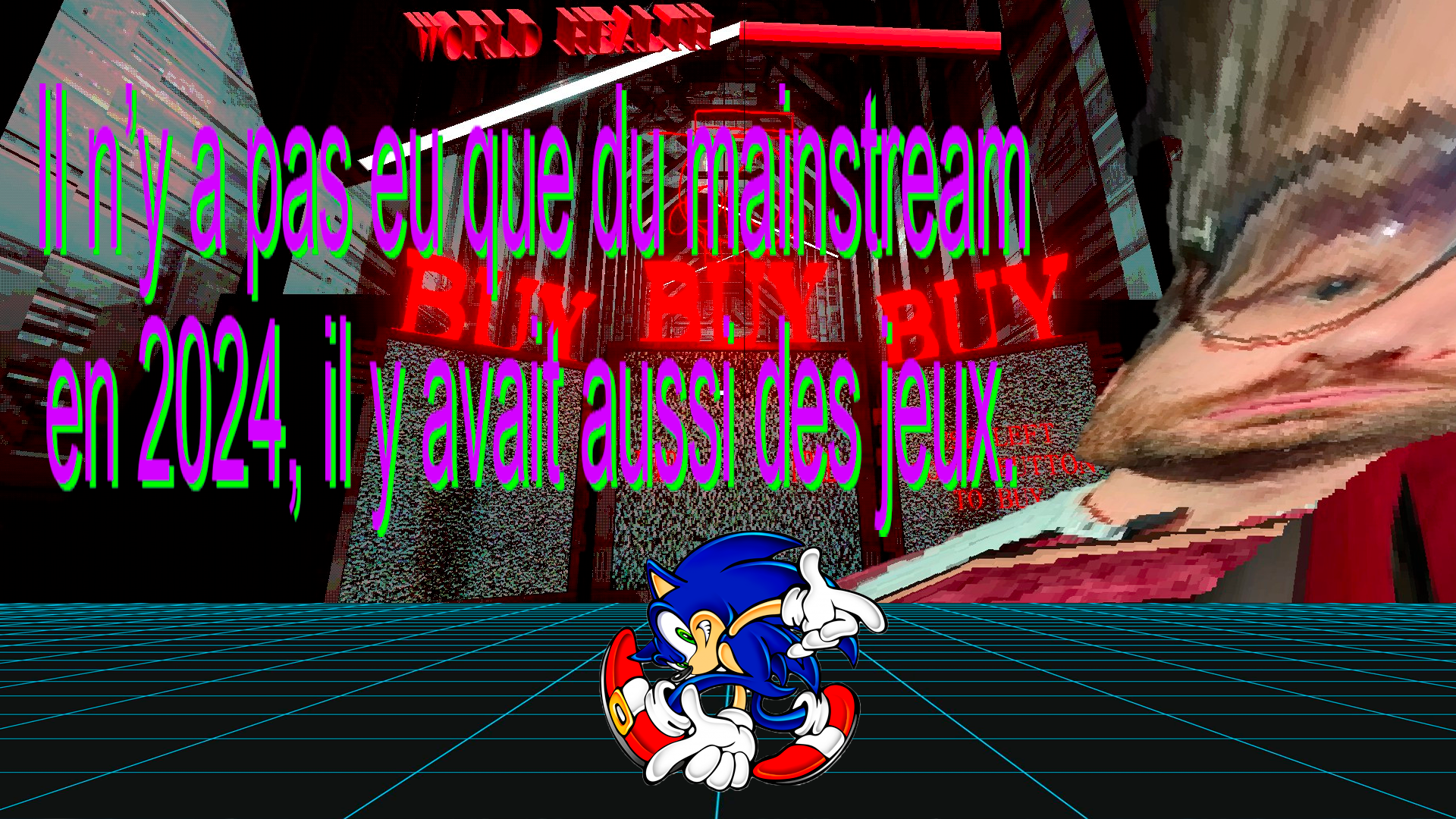
![15 000 likes pour avoir parler de Philippe Katerine ? Avec des fautes d’orthographe en plus ?? [LINKEDINCORE]](https://www.chroniquesvideoludiques.com/wp-content/uploads/2024/08/philippe-katerine-jpg34.jpg)


