-

Les arts ne sont-ils que des formes de jeux ? – TikTok Files
« Mais c’est pas du jeu vidéo, ça. C’est du cinéma. C’est ça que les gens comprennent pas. Et l’argument des jeux vidéo, c’est de l’art, ok, mais il faut utiliser la force même du jeu vidéo. C’est le gameplay, c’est la narration et l’interactivité. Lorsque les jeux vidéo sont interactifs intelligemment, là, c’est de l’art. »…
Le carnet de recherche d’esteban grine.



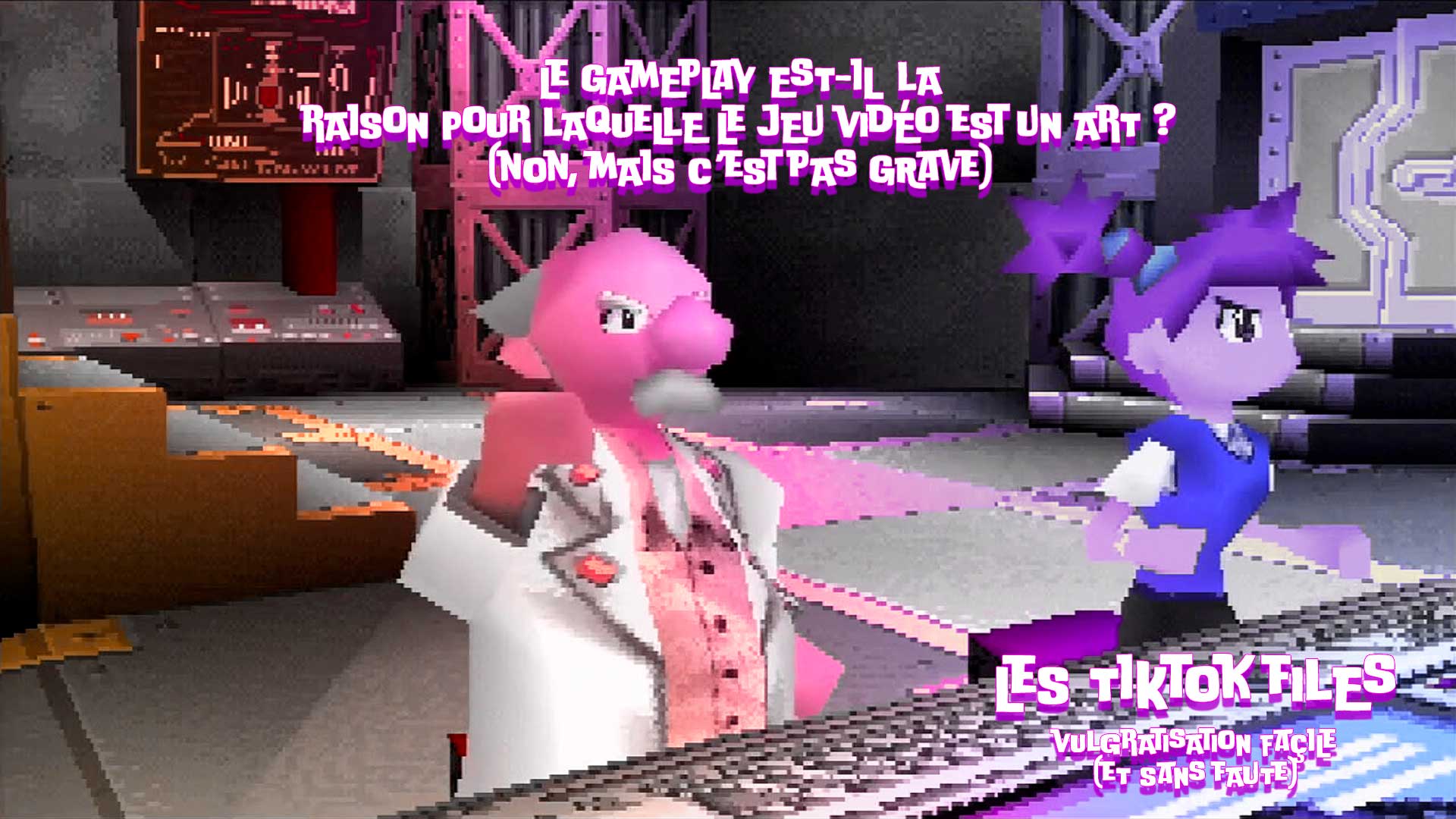


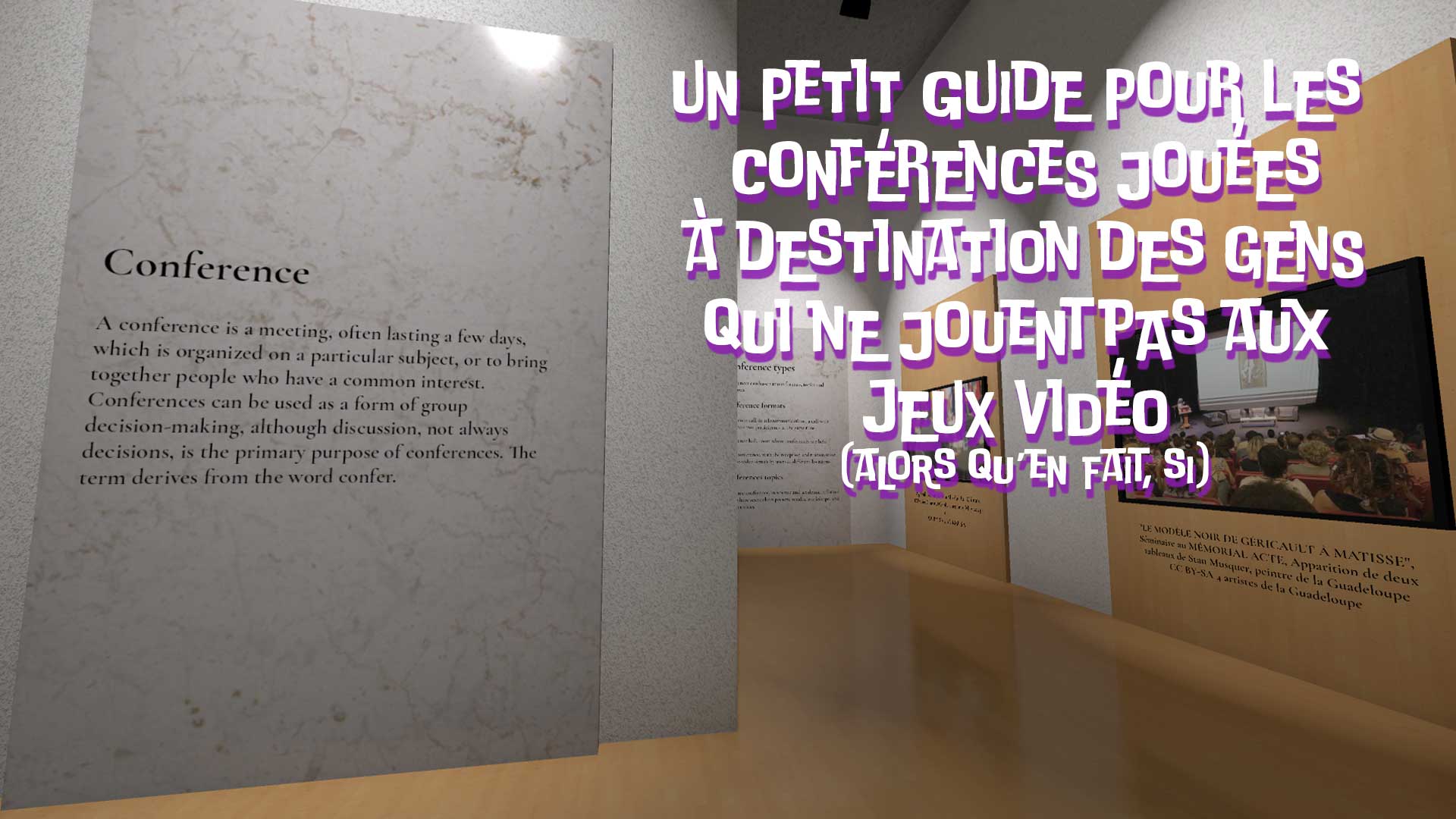

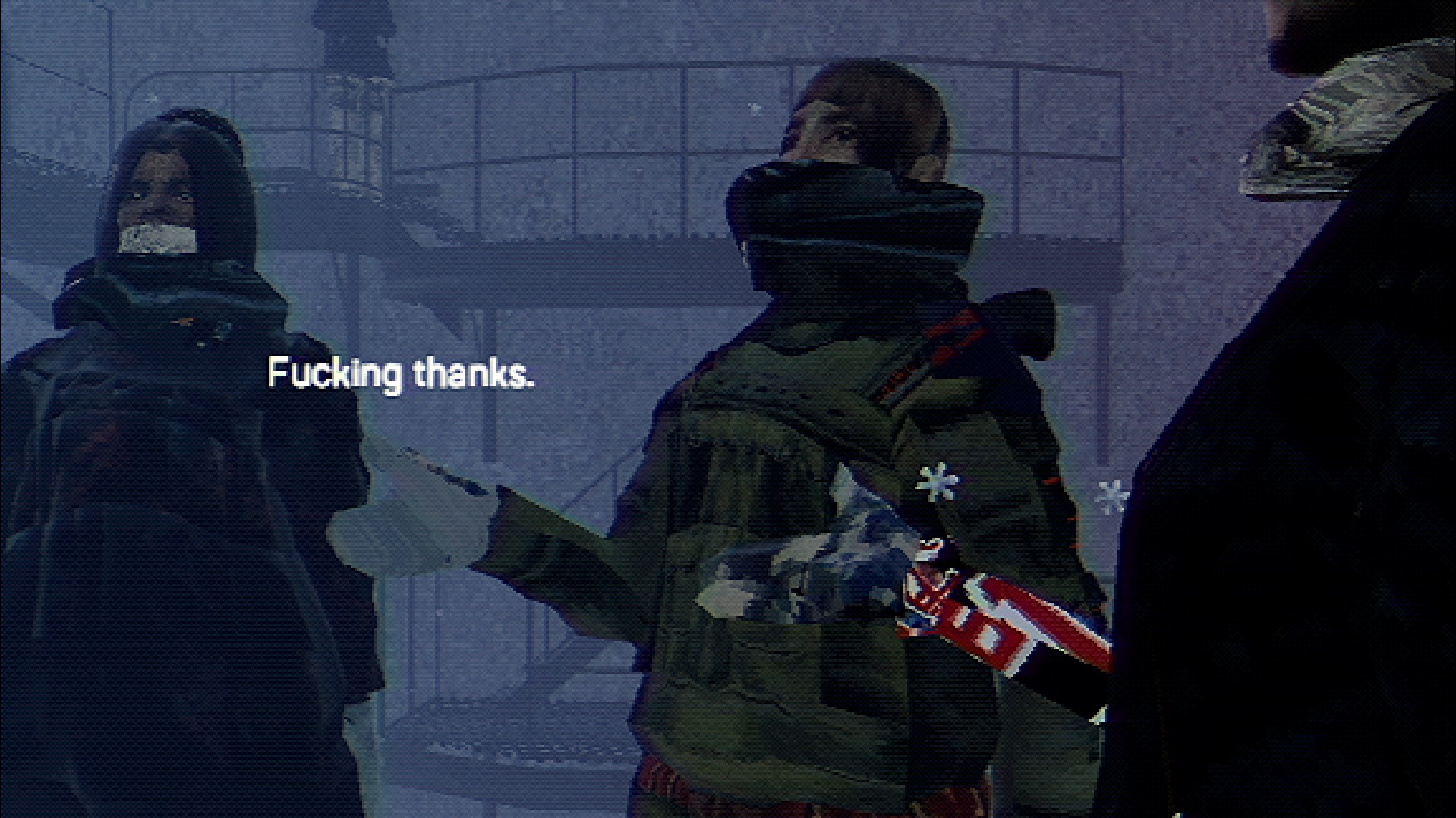


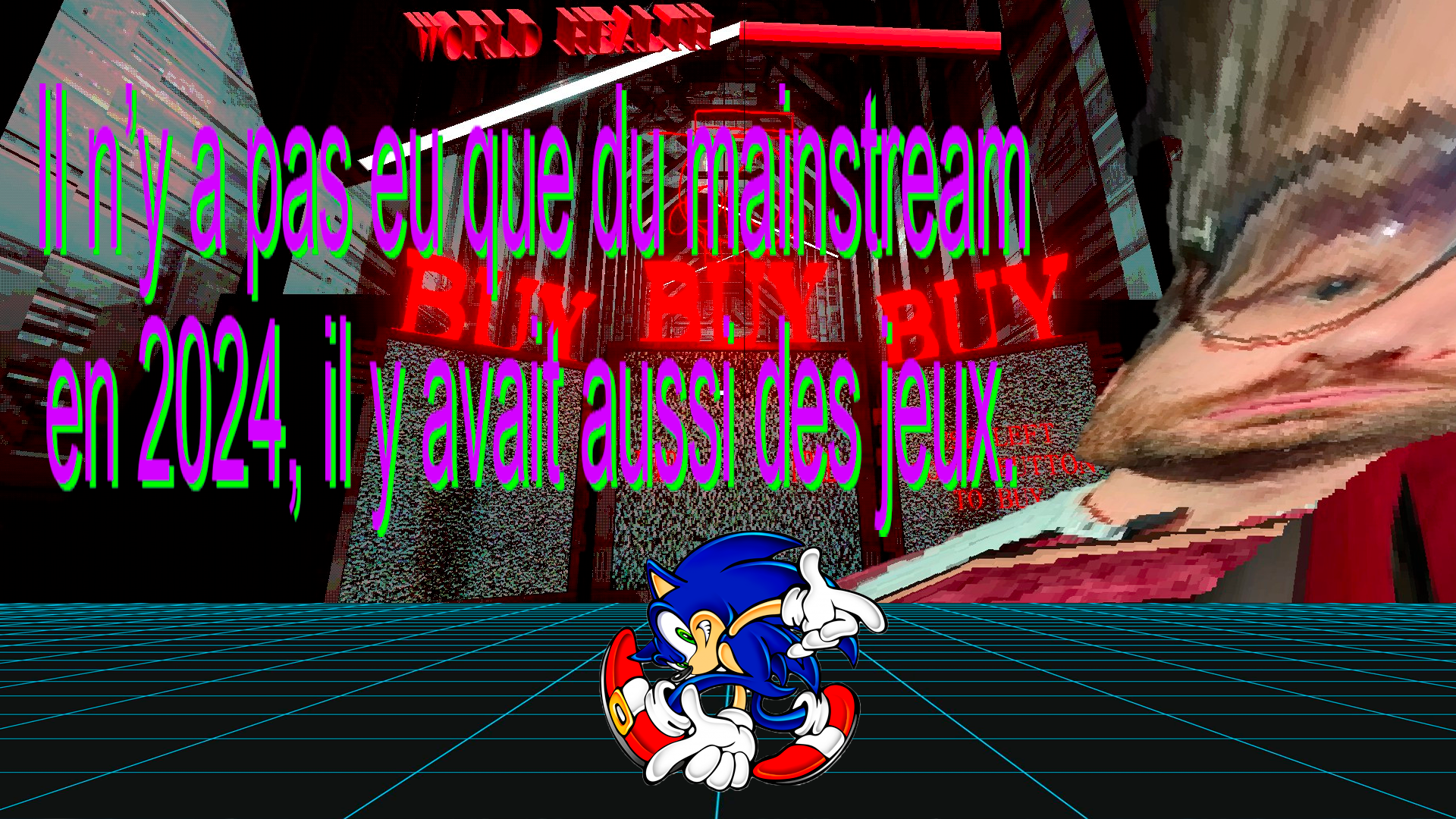
![15 000 likes pour avoir parler de Philippe Katerine ? Avec des fautes d’orthographe en plus ?? [LINKEDINCORE]](https://www.chroniquesvideoludiques.com/wp-content/uploads/2024/08/philippe-katerine-jpg34.jpg)